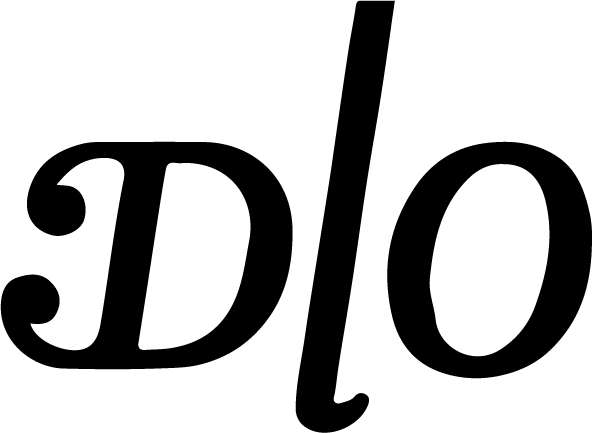La langue : meutre, assassinat et crime parfait.

Autour du TUEURS DE MOT.
Ph. Choulet, avril 2012
Que de violence et de sang gisent au fond de toutes les bonnes choses! Nietzsche fait de ce principe celui de sa méthode généalogique. Eh bien, justement, nous qui admirons la langue, les langues, leur richesse, leur originalité, leur étrangeté, nous pouvons examiner la nature de cette “violence” qui gît sans doute au sein de cette bonne et belle chose qu’est le langage humain. Nous voudrions pointer trois formes de violence qui montrent que la langue est une histoire de meurtre, d’assassinat et de crime parfait (1)…
I. Une affaire de meurtre. La méditation sur la nature du signe linguistique a fourni cette conclusion dramatique: le signe est le meurtre de la chose. L’expression se trouve dans La phénoménologie de l’esprit, de Hegel. Cette idée, mieux, cette “réalité” constitue la condition de possibilité d’une autonomie, d’une indépendance radicale de la langue comme système de signes par rapport à la réalité sensible matérielle. Il y a d’une part le chêne réel, la table réelle, et il y a d’autre part le signe “chêne”, le signe “table”… Comme dit Spinoza, le mot “chien” n’aboie pas. Proust a bien synthétisé ce problème: «Nous sentons dans un monde, nous pensons, nous nommons dans un autre, nous pouvons entre les deux établir une concordance mais non combler l’intervalle (2)» . Proust ne dit pas qu’il s’agit de l’annihiler, de l’annuler, de le supprimer, mais simplement de le réduire…
Cela signifie que la langue est un système sui generis, une logique sensible psychique, qui lie entre eux de manière très forte des signes (définis par l’unité d’un signifié et d’un signifiant) par ce que Saussure appellera l’“arbitraire du signe”. Cet arbitraire du signe ne se situe pas tant, comme le pensait Saussure, encore réaliste, entre le signe linguistique et la réalité qu’il est censé nommer (le chêne, la table), qu’entre le signifiant — l’image acoustique, le son mental — et le signifié (l’idée, le concept, la notion), ce qui est la pensée de Benveniste. Ce qui permet de comprendre le jeu de liberté et de sens entre le signifiant “justice” et la notion (plurielle) de la justice. La langue est bien ce qui détermine notre intériorité comme système de signes organisé (et pas comme nébuleuse vide, informe et déstructurée)… ce qui signifie que notre intériorité est essentiellement linguistique (la psychanalyse dira: “symbolique”), bien plus qu’affective ou sentimentale…
Ce meurtre de la chose permet de comprendre comment et pourquoi la langue est un système, un univers en expansion, une espèce de big bang à elle toute seule, un monde qui augmente par la vertu d’une “création continuée” immanente (nul besoin d’un démiurge, d’un Dieu)… Et certes, la langue peut s’étioler, s’appauvrir, devenir mécanique: la manie de l’euphémisme, avec son côté tabou et cache-sexe (“mal voyant” au lieu d’aveugle, “technicien de surface” au lieu de balayeur, “personne de petite taille” au lieu de nain, etc.). Le phénomène d’appauvrissement, de rétrécissement du champ de conscience est alors analogue à un big crunch… Et certes, les langues peuvent disparaître (pensons aux langues des peuples du néolithique, de ces peuples dits “primitifs”, qui disparaissent peu à peu, et avec eux, leurs langues, leurs cultures, leurs univers symboliques, leurs mythes, etc.) — preuve que les choses n’y peuvent rien. Ou encore, elles peuvent se maintenir dans une “vie” culturelle, une vie du savoir et de la transmission: c’est le cas des langues mortes.
La langue est une réalité psychique culturelle, une institution (Saussure), qui en tant que telle s’affirme avec toutes les contraintes adéquates aux esprits individuels, elle s’impose à eux, par la grammaire, la syntaxe, l’orthographe, la constellation du sens des divers signes qui la composent…). Véritable réel (psychique), elle résiste à la connaissance (la linguistique est science tardive: fin du XIXe siècle, avec Pierce et Saussure) et au changement (on n’intervient pas aisément ou impunément par un diktat et un caprice du libre-arbitre sur ce système…).

Mais cette autonomie n’est pas innocente, elle comporte une négativité, car elle se conquiert à partir d’un meurtre. La langue ne va pas de soi, en raison de cette violence même. Il y a quelque chose d’œdipien dans ce geste du meurtre de la chose: la mort du père — le père, ici, c’est le réel sensible matériel (le système des choses). Ou plus exactement (car le verbe “conquérir” suppose un processus…), elle est constituée par un saut, une discontinuité: le sujet de la langue saute à pieds joints dans une autre réalité que la réalité sensible matérielle et physique et qui est une réalité psychique. Telle est la rançon de son émergence, de cette “création” (qui laisse dans l’énigme le fait de savoir si c’est l’homme qui invente la langue ou si c’est la langue qui invente l’homme…).
Mais ce meurtre, comme le péché d’Adam et Eve, a une positivité dialectique et spirituelle — sans lui, pas d’esprit. Le meurtre de la chose fait entrer l’humanité parlante dans l’histoire, et c’est le signe qui devient la chose même. C’est le sens que donne Mallarmé à sa formule «Je dis: une fleur! Et (…) musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets» (Crise de vers). Le signe “une fleur”, ici appelé à paraître / apparaître / comparaître à l’esprit par la force même de l’esprit, réalise proprement l’absence de la fleur visée en question (la chose se met à manquer), et en même temps la présentifie dans cette visée même sous la forme du signe.
Je peux parler de la chose en son absence. En en parlant, je profère un signe qui ne saurait paraître dans quelque bouquet que ce soit, et pour cause !(3) Le signe est donc bien la mise en absence de la chose. Le signe exclut la chose, en venant, littéralement, “à sa place”. Il est ce qui fait que la chose est là tout en n’y étant pas(4) . Ce qui fait que je ne sors pas de moi-même — autonomie de l’esprit, qui peut ainsi développer son monde et son savoir (Hegel). Lacan rappelle que les emmerdements des éléphants ont commencé quand les hommes ont commencé à parler des éléphants(5) . Et Swift(6) parle de cette peuplade qui préfère parler des choses en en présentant un échantillon réel: ainsi, ne parler des animaux qu’en leur présence, cela constitue un bien lourd handicap (pour traiter du rhinocéros ou de la baleine, il faudrait avoir un rhinocéros ou une baleine sur soi… et comment faire alors pour parler d’idées et de valeurs comme la Justice, la Paix, la Dignité? Et pour les morts, pour parler de Landru, de Jack l’Eventreur, de Jeanne d’Arc, on fait comment?)…
Bref, vive le meurtre (de la chose)! Ce meurtre n’est ni à regretter ni à maudire: c’est la condition de possibilité de la parole articulée, de la pensée et du jugement, bref, de l’énonciation. Mais on le voit, l’entrée dans la langue commence mal…
II. Après le meurtre, l’assassinat… C’est tout le danger de la démocratie des langues — et chacun sait que la démocratie, c’est la guerre, le conflit, la dispute, la divergence des avis… Il y a une égalité de principe des langues entre elles, mais cette pluralité s’exprime aussi dans la rivalité. Il y a donc bien un conflit, qu’on dira “normal”, celui d’un “droit naturel” des langues — les langues d’Etat contre les patois, les langues régionales, minoritaires (par exemple, la langue d’oil contre la langue d’oc, ou encore la déclaration de la primauté et de l’exclusivité du Français dans les documents publics du royaume de France, avec l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, août 1539, sous François 1er. Lévi-Strauss avait prévenu: l’ethnologie tient la rubrique nécrologique de l’humanité (c’est le thème mélancolique de la fin de Tristes Tropiques).
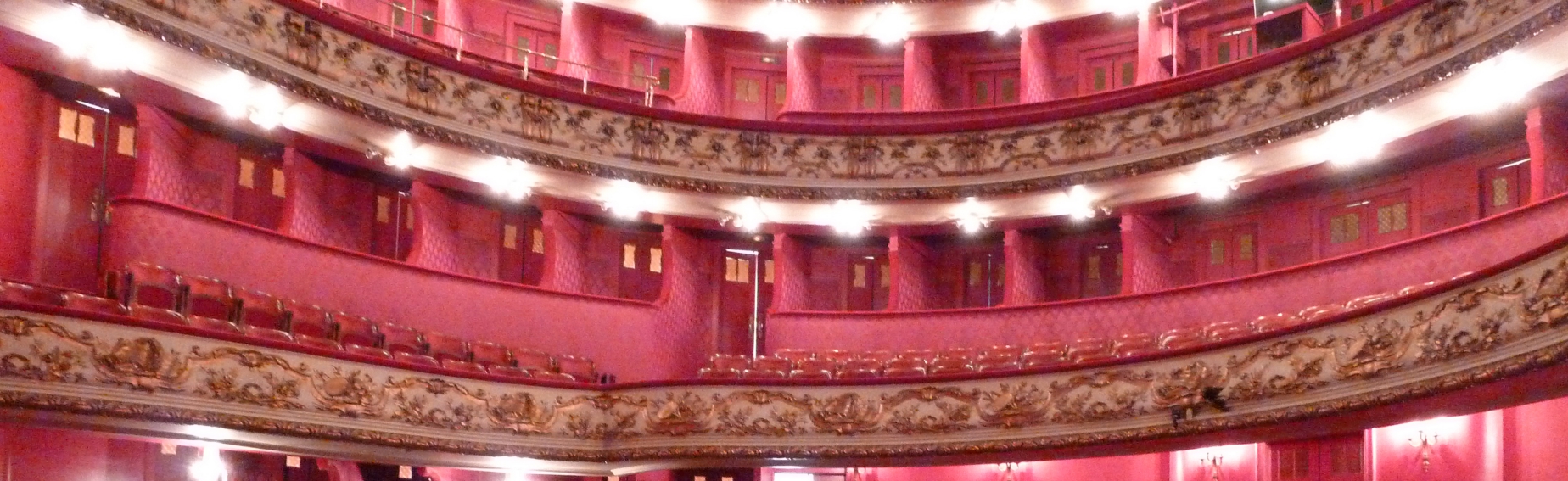
Il s’agit bien de prendre acte de cette disparition dramatique et tragique des langues (“tragique”, car la disparition d’une langue est bien comme celle d’une espèce vivante: c’est un irréversible, ni la Nature ni la Culture ou l’Histoire ne les réinventeront). L’enjeu est bien celui de la sauvegarde de la biodiversité des langues. Mais il y a aussi un conflit “pathologique”, comme celui de la langue totalitaire (la Nov’langue) contre les langues vivantes spontanées, ou le triomphe décérébrant de “l’anglais pakistanais” (le globish), de la langue artificielles du management, du coaching, de la publicité (le slogan publicitaire) et des langues d’Etat (fantasme dominant du XXe siècle) contre les langues concrètes particulières et singulières. Ultra-violence d’une langue, qui se prend pour le tout et qui fantasme l’éradication des rivales.
Il faut ici rendre hommage à Armand Robin, écrivain, poète, traducteur, dont le métier était chroniqueur de radio (chargé d’écouter les radios étrangères et de faire des comptes rendus pour les abonnés). Robin voulait «devenir tous les hommes et tous les pays», comme le tigre de Borges est tous les tigres, et le rossignol de Keats tous les rossignols. Il entend lutter contre les “éperviers mentaux” que sont les dirigeants totalitaires, les censeurs, la Police politique, etc. La poésie est une arme de résistance à la guerre que les Etats mènent contre la langue et l’esprit des langues(7) …
Là est la menace de l’assassinat. Le triomphe unilatéral d’une langue révèle un effondrement de cette langue: elle n’en est plus une, se réduisant à une mécanique sans esprit et sans vie, à un système réflexe de stimuli et de réponses. C’est la décérébration des esprits, la déspiritualisation des cerveaux qui est en jeu(8) . C’est à la langue de construire sa propre défense contre la violence du langage totalitaire (LTI chez Klemperer, nov’langue des utopies négatives(9), propagande, définie par Robin comme un «sous-langage universel», ou comme le «déchaînement scientifiquement calculé de forces mentales obsessionnelles(10)» . Ce sont les langues qu’on assassine.
Alors, contre cet assassinat programmé, que faire? Pour sauver une langue, il faut la respecter, et pour la respecter, il faut l’apprendre, la mémoriser, la réécrire, la traduire. Les Israéliens ont commis le tour de force de rendre à l’hébreu son statut de langue vivante, et si le latin et le grec sont des langues “anciennes”, elles sont moins mortes que prévu… Dans Fahrenheit 451 (Bradbury) — songeons au film de Truffaut —, les rescapés des forêts sauvent leur langue et leur culture en mémorisant chacun un livre. C’est la question qui concerne la dignité de chacun: quel livre voulez-vous apprendre? Quelle langue voulez-vous sauver?…
III. Et enfin, le crime parfait. Là encore, comme avec la question du meurtre de la chose, nous allons cultiver le paradoxe. Il s’agit de nouveau de faire l’apologie de la langue, de toutes les langues, en invoquant la perfection de ce que Lévi-Strauss appelle “la pensée sauvage”…
Il y eut un vieux rêve, celui de la mathesis universalis, dans le siècle de Descartes et de Leibniz(11) : l’entendement pur a imaginé la possibilité d’une langue absolument parfaite (artifice conventionnel, rationnel, appuyé sur l’univocité, l’objectivité, la nécessité logique et la rigueur implacable…), comme si les langues naturelles étaient faibles, contingentes, aléatoires, imprécises, instables, ambiguës, malades d’équivocité, d’opacité, etc. Contre cet idéal de la raison, il faut dire et redire que toutes les langues sont parfaites en leur genre, et donc que chaque langue humaine est universelle, riche d’une universalité en puissance, uniquement parce qu’elle est humaine.
Et que rien d’humain ne lui est étranger. Cette transversalité des langues est décisive: chaque énoncé de chaque langue est éminemment traduisible dans n’importe quelle autre langue naturelle, il suffit de trouver des équivalents. La phrase de Proust citée plus haut se transpose aisément au rapport entre les langues… Babel n’est pas le capharnaüm de l’incompréhensibilité, de l’incommunication ou de la schizophrénie des langues entre elles, elle est la Tour de l’éminemment traductible, l’infra-traduisible qui lie les langues entre elles (relisons Borges…).
Chaque langue est parfaite car elle a inventé sa propre logique et son propre cosmos, elle a formé son propre monde sensible, elle nomme comme il faut, toujours comme il faut ce qui lui convient(12) . Chaque langue indique toujours suffisamment comme il faut pour qu’on n’en fasse pas une objection, alors que c’est un argument en sa faveur. Chaque langue révèle toujours suffisamment comme il faut. Il ne sert à rien de demander quoi que ce soit d’autre. Le rêve d’une langue parfaite supérieure, finalement, c’est de la “misologie” (i.e., de la haine de la langue — haine des langues —, de la haine de la raison).
Ainsi, les divers noms de la neige en inuit distinguent chacun des états différents de la neige, selon les besoins primordiaux (dans ces conditions extrêmes, se tromper de “neige”, de mots pour la neige, c’est mortel…). Chaque langue nomme toujours suffisamment comme il faut. L’indication, dit Hegel, vise le maintenant dans son universel. Il n’y a pas de mots inutiles, même les plus terribles: “shoah”, “extermination”, “éradication”, “nettoyage ethnique”, “football”, “fraise tagada” (chassez l’intrus et barrez la mention inutile…). En ce sens, l’imparfait, ce n’est jamais la langue, mais toujours le locuteur, l’homo loquax, l’être parlant ou déparlant / délirant parce qu’il ne sait pas parler, ou qu’il ignore ce que parler veut dire…).
Aussi peut-on dire que: nommer, c’est indiquer, montrer, faire voir, faire entendre. Le nom est un instrument d’optique et d’écoute (de compréhension). Le nom relève d’un art de voir (de voir et des ressemblances et des différences). Le nom est principe d’originalité: «Originalité. — Qu’est-ce que l’originalité? Voir quelque chose qui n’a pas encore de nom, qui ne peut pas encore être nommé, quoique cela se trouve devant tous les yeux. Tels sont les hommes habituellement que c’est seulement le nom des choses qui les leur rend visibles. — Les hommes originaux ont été généralement ceux qui donnaient des noms aux choses.» (Nietzsche, Gai savoir, § 261)
Eh bien, voilà ce qui sauve de nouveau nos langues, car ce crime parfait, c’est cela qui proprement s’appelle un baptême.