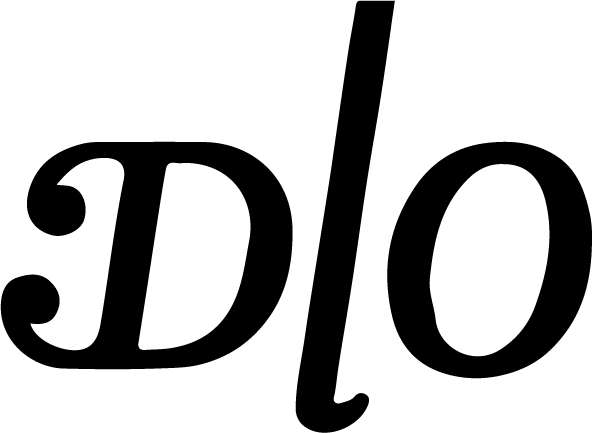Le réalisme de Friant
Ph. Choulet (Des’Lices d’Opéra – 06-11-2013)
Faire entendre une “voix philosophique” sur Friant, à propos d’une philosophie de l’art et de la question esthétique, voici le programme qui m’est proposé.
Je procéderai en deux temps.
Le premier sera consacré à une exposition des problèmes philosophiques de la création artistique, et en particulier en peinture, et mon discours vaudra pour Friant et pour tout autre, qu’il s’agisse de Tartempion ou de Machin-Chose…
Le second sera consacré à l’examen de la manière singulière par laquelle Friant a voulu résoudre ces problèmes, et en particulier la question du réalisme. Le problème que je vois chez Friant, c’est celui-ci: comment concilier réalisme et illusion? Volonté de réalisme et devoir d’illusion — dans la mesure où l’art relève fondamentalement de l’illusion ludique.
Friant peintre classique
La raison de notre travail sur Friant, c’est qu’il est un peintre classique. “Etre un classique” a deux sens. C’est d’une part:
a) le tenant d’un style figuratif, d’une forme de naturalisme qui respecte les impératifs de mimèsis et de la reproduction, en essayant de respecter le modèle par une certaine teneur de l’illusion picturale. Sont ainsi des classiques, en ce sens, Léonard de Vinci, Raphaël, Antonello da Messina, Dürer, Chardin, etc. Même dans notre modernité picturale, hantée, voire terrorisée, par l’abstraction et le minimalisme, avec des artistes comme Friant ou Bastien-Lepage, comme plus tard encore avec Hopper, Rustin (peintre mosellan, né à Montigny les Metz), Rockwell, grâce à eux, on peut encore voir notre monde en peinture…
b) une référence nécessaire, incontournable, une sorte de modèle d’un certain genre ou d’un certain style. C’est pour ça qu’il faut «réviser nos classiques». C’est le problème de l’historien d’art, de l’historien de la culture, et même du Ministre de l’Education nationale (dans un programme scolaire, que doit-on enseigner et transmettre, sinon d’abord les Classiques, et alors: qui est digne de comparaitre parmi ces Classiques?). Mais Friant n’est pas encore un Classique comme Delacroix, Kandinsky, Picasso, Van Gogh ou Rembrandt… Friant est exclu de la liste, sans doute parce que c’est un peintre sage, qui ne fonde certes pas un style nouveau, disons un écart suffisant par rapport à la norme dominante de l’époque… De toute façon, pas regret: les artistes fondateurs, les artiste législateurs, comme dit Nietzsche, sont rares. En comparant le style de Friant avec celui de certains de ses contemporains les plus brillants, Ensor ou Munch, on constate qu’il n’est certes pas révolutionnaire — mais après tout, justement, nul n’est tenu de l’être, en politique comme en art. D’ailleurs, c’est fatiguant, un monde où il n’y aurait que des révolutionnaires… Cela dit pour en avertir les tenants de l’art contemporain (les tenants de la révolution permanente, de la (re)fondation permanente…). Et remarquons qu’en peinture, comme dans tout autre art, il y a quelque chose de plus essentiel que d’être révolutionnaire, c’est d’être parfait, de faire du parfait, de parfaire ce qui est fait…
Friant réalise cet essentiel, au sens où il sait ce que c’est que la nécessité intérieure et l’exactitude d’un tableau. C’est pour cela qu’il est, bien que non législateur et non révolutionnaire, un Classique tout de même, c’est-à-dire un Modèle… en son genre. C’est bien aussi ce qu’on demande aux “petits maîtres”, de faire du parfait (je pense à Valenciennes, à Dagnan-Bouveret, à Fernand Pelez, à Aimé Morot, à Christian Krogh, à Lhermitte, à Edelfelt, à Eugène Buland, à Hubert von Herkommer, à Galle-Kallela, et tant d’autres…).
La question qui s’est posée à Friant est la suivante (entre parenthèses, c’est la question du naturalisme): étant donné un monde, que puis-je en faire? Un monde, c’est-à-dire des formes, liées entre elles par des rapports nécessaires, harmonieux ou contradictoires, évidents ou étranges. Ces formes, ce sont des mouvements et des couleurs, des surfaces et des profondeurs, des paysages, des corps, des visages, des masques, des expressions, des affects et même des pensées…
Que signifie peindre?
Que faire donc de ce monde quand je suis peintre? Le tableau est une sorte de mur, sur lequel j’écris, mais il me bouche la vision, il m’empêche de voir le monde, il me prive de ma vision naturelle, et m’oblige, me contraint, à commencer à le voir autrement, forcément, afin que je puisse en produire un analogue. L’image mentale, l’image picturale sont des analogon des formes du monde, et on peut en dire autant des vers de la poésie, des fables romanesques, des pièces de théâtre ou des poèmes symphoniques… Cela veut dire que le tableau est d’abord un obstacle, puis un moyen, un medium, un instrument d’optique, qui intervient (intervenir, c’est “venir entre”) entre moi et le monde, dans un premier temps, puis qui intercède pour que ce monde m’accorde une vision de lui-même. Il y a la vision Ensor, la vision Rockwell, la vision Friant, etc. Autant de styles, autant de visions. Et oui, ce tableau intercède. C’est ici que la question du réel s’amorce. Car intercéder auprès de qui?… Eh bien, on n’en sait rien, et vous pouvez répondre selon vos croyances: ça peut être auprès de Dieu (le 1er Van Gogh, Chagall, Rouault), auprès de la Vie (Cézanne, Max Ernst), auprès de la grande Nature (Delacroix), auprès de l’esprit (Kandinsky ou Klee), auprès de la Raison liée à l’Imagination(2) Piero della Francesca, Alberti, Leonard de Vinci et l’invention de la perspective, Comme disait Tardieu: «étant donné un mur, qu’y a-t-il derrière?» Avec la peinture, c’est plutôt: étant donné un mur, qu’y a-t-il dedans?)… Nous avons en tout cas le choix de l’invocation de la Puissance, avec un grand “P”. Quelque chose de religieux, sinon de sacré.
Le problème de Friant n’est pas réglé pour autant. S’il était réglé, la peinture serait magie. La magie, c’est la production des effets avec dissimulation des processus de production des effets. Magie, elle l’est, la peinture, dans l’effet de perfection de l’illusion qu’elle produit sur nous — le peintre a travaillé, il a enlevé les échafaudages, il a supprimé les esquisses et les bavures, il nous épargne la vision du processus, nous n’avons droit qu’au résultat fini, achevé, parfait, terminé… Ce qui est fait est supposé n’être pas fait, dit Nietzsche dans Humain, trop humain — je reviendrai sur ce présupposé d’achèvement et de terme.
“Fini” est révélateur, ici, il signifie finitude et finition, limitation et perfection: ce tableau n’est certes qu’un point de vue limité, partiel, partial, arbitraire, sur le monde, mais en même temps il est parfait en son genre. Bonne nouvelle, la perfection est de ce monde, et on peut ainsi toujours voir ce monde en peinture…
Cela dit, pour régler son problème, Friant a besoin d’autre chose que de ce simple rapport de face à face, en chiens de faïence. Car il y a un quatrième élément à faire venir, et même à inventer, entre le tableau, le peintre et le monde, c’est le style. Par style, j’entends la manière (maniera, disaient les Italiens de la Renaissance, la touche manuelle, la “patte”), plus ou moins volontaire, plus ou moins cohérent, dont un artiste produit à la fois des formes intérieures (de l’affect(1) à l’imagination, de l’inconscient à la raison pure) et des formes extérieures. “Produit”, c’est-à-dire qu’il ressent, qu’il imagine, qu’il conçoit, qu’il construit des formes intérieures (des schèmes), pour en même temps les exprimer, les projeter sur le mur du tableau. Je dis “en même temps”, car évidemment, s’il s’agissait d’un travail simplement technique ou simplement artisanal, ce serait “ensuite” (selon une antériorité chronologique: j’imagine d’abord la forme, je la matérialise ensuite, selon la déduction), mais là il s’agit d’art, et dans le processus de concrétisation sensible de la forme, le travail d’invention et de création s’opère bien en même temps, au fur et à mesure, dans un work in progress, dans la double imprévisibilité de l’imagination et du geste, qui se répondent l’un à l’autre et se nourrissent l’un de l’autre, dans une coopération réciproque — ce qu’on appelle induction. C’est un des problèmes esthétiques de la création.
Bref, de quoi Friant a-t-il besoin, comme tout artiste, pour peindre? D’une vision intérieure. Il partage ce souci avec tout autre artiste, il n’y a rien là qui le singularise. L’artiste doit se donner à lui-même cette vision, par auto-affection de l’imagination, par le travail de la libre imagination, qui s’émancipe donc peu à peu, ou radicalement, de la vision organique naturelle qui est la nôtre. Quand je dis “l’artiste doit se donner à lui-même cette vision”, il va de soi que je ne veux pas dire que cette vision est nécessairement de l’ordre de la volonté. Vous pouvez toujours espérer «être Chateaubriand ou rien», mais si vous n’avez pas le talent… Ce sont des choses qu’on peut bien vouloir, mais la volonté n’y fait à vrai dire pas grand chose, nous savons qu’il y a bien des situations où il ne sert à rien de vouloir, où vouloir est vain parce que là n’est pas le problème. Ce qui convient ici, c’est de bien vouloir laisser venir à soi les formes qui nous appartiennent, le “trésor de formes” qui gît en nous, de manière actuelle et potentielle. Cela suppose une forme d’abandon: il faut “lâcher”, pour parvenir à recevoir des formes qui viennent d’on ne sait où. La création de formes suppose ce moment précieux de passivité. Ce trésor de formes est dans le système de la peinture (comme il l’est dans le trésor de la langue, dit Saussure), et dans notre imagination. C’est à l’artiste de le révéler au monde dans et par son processus de production.
Comment peut-on être réaliste? Comment peut-on être naturaliste ?
Le naturalisme est, comme son nom l’indique, une forme de style qui fait référence à la nature ou à une nature. Mais de quelle nature s’agit-il?
Même remarque pour le réalisme. Tout réalisme fait référence au réel ou à un réel, et la question est de savoir de quel réel il s’agit.
La question commune, c’est donc la référence. La référence, c’est à la fois 1° le modèle à “reproduire” par analogie (dans un portrait, par exemple), et 2° la source d’inspiration, l’origine ou le trésor des formes (ce dont l’artiste est le porte-parole, le porte-plume, le porte-pinceau…) — le Réel, la Nature.
En art, il s’agit de transcrire un «réel», d’en être le témoin et le passeur, parce qu’il est conçu et posé comme source, principe, modèle.
De quel réel s’agit-il? “Le réel se dit en de multiples sens”, comme Aristote le dit de l’être, et que tout dépend du référent qu’on élit comme «réel», ou plutôt qu’on finit par élire comme réel. Question de décision. A la limite on peut dire qu’il n’y a pas de réel, mais une fonction de réel, et c’est cette fonction de réel, de l’ultime réel qu’est le référent.
Du réel, il y en a des tas: le réel physique, le réel affectif, le réel psychique, le réel institutionnel, le réel social, le réel politique, le réel moral, etc. Parfois, c’est la Nature qui est l’ultime réel, pour d’autres — pour le réalisme fantastique, par exemple — c’est le réel, mais un réel psychique, qui est en deçà ou au-delà de la Nature… Parfois c’est juste le réel perçu par la vision naturelle organique, parfois, c’est la vision intérieure, plus ou moins indépendante de la Nature ou du réel sensible perçu… Le réalisme est un tropisme: une volonté de réel, avec ce présupposé: le réel est le vrai, et le vrai est du réel, dans le réel, plus que dans le rêve, la rêverie, l’idéal. Il faut être au plus proche d’un réel.
Des réalismes aussi, il y en a beaucoup et cela force à user d’adjectifs déterminants: le réalisme formel de Brecht ou de Chostakovitch, le réalisme fantastique de Berlioz, Murnau ou de Fritz Lang, le réalisme naturaliste de Balzac, de Flaubert, de Maupassant, de Zola, d’Ibsen ou de Strindberg (même s’il y a chez eux, également, des éléments fantastiques) — et chez Friant également, il y a plusieurs formes de réalisme…
C’est d’ailleurs là où je veux en venir, admirez la coïncidence…
Ainsi, on peut distinguer: un réalisme naturaliste (Zola — le mendiant dans La Toussaint), un réalisme fantastique (Maupassant, Poe), un réalisme socialiste, peut-être suffisamment fantastique pour séduire les foules…, un néoréalisme italien au cinéma, un réalisme épique, comme chez Brecht, un hyperréalisme (Norman Rockwell), etc.
La recherche des formes de référence qui travaillent chez Friant est ainsi un moyen pour moi de parvenir à ce qui nous fascine chez lui.
Le travail du réalisme chez Friant
Le réalisme obéit à un principe de fidélité, quand on prend le réel comme «modèle». C’est donc une manière de voir, d’entendre, d’interpréter, donc une manière de retranscrire le réel, de le “re-produire”, de le traduire. L’idéal réaliste, c’est la plus mince couche entre le réel et sa duplication. C’est comme le “top model” des années 90: la minceur, la feuille de cigarette. Du plus précis possible à l’exact… Question de mesure, de degré de négligence, d’un droit à la négligence… Questions de Friant: Comment la perfection artistique est-elle compatible avec ce droit à la négligence? Qu’ai-je le droit de négliger pour produire l’illusion picturale?
On peut certes durcir les différences, mais on peut aussi les évaluer selon des différences de degré. Nous revoici dans Friant, justement. C’est comme sur une règle avec un curseur: certaines œuvres sont franchement naturalistes, d’autres sont franchement réalistes — chez Friant, ces dernières sont celles qui rivalisent le mieux avec la photographie, art qui s’est d’abord voulu réaliste, et on le voit bien dans les dessins de Friant.
Ici apparaît le problème esthétique et artistique, le passage de la perception à la traduction, c’est-à-dire la méta-phorisation, l’analogie, le transfert des données sensibles et des formes à l’œuvre sensible et à ses formes. Le postulat 1er de l’art réaliste est de prétendre re-transposer, retranscrire, décrire, sous d’autres conditions (par l’écriture, l’image, l’espace à 2 dimensions) un réel perçu, senti, observé, bien défini (sans doute extrait, prélevé, choisi dans un réel plus large et plus indéfini), et également pensé, conçu (car il y a aussi un principe théorique gouvernant le style), défini comme principe de référence.
Le problème est que les moyens diffèrent selon les formes diverses de réalisme: la perception est elle-même déjà traduction, transcription, interprétation, modification, choix, prélèvement. Donc, première variable, cela dépend du système de sensibilité, des conditions de réception. La sensibilité, l’œil d’un Friant n’est pas assimilable à ceux de ses congénères, il y a toujours la plus petite différence possible déjà dans l’infra corporel de l’esprit du peintre. Puis les moyens picturaux utilisés pour la transcription diffèrent, y compris dans l’unité même d’une œuvre, où Friant sait alterner et parfois mêler les trois factures (celle du pictural, du dessin et de la photographie), et ce pour davantage d’efficacité. Chez Friant, cela donne la répartition suivante:
1° des œuvres naturalistes et quasi romantiques, qu’elles soient des scènes de genre, tantôt campagnardes (Le repos des artistes (1880), Le steen d’Anvers (1887), La lutte (1889), La discussion politique (1889), Sur la route de Biskra (1892), Panneau des jours heureux (1895), La petite barque (1895), Les baigneuses (1898), Soir d’été (1901), Tendresse maternelle (1906), En pleine nature (1924), …), tantôt urbaines (La porte Saint-Georges, 1878, L’entrée des clowns, 1881), ou de l’ordre des natures mortes (Le tube de gouache, 1877), de l’ordre du portrait (L’autoportrait à 15 ans, de 1878; Portrait du peintre jeune, 1877, Portrait de M. Sidrot, 1881, Portrait de Mme Petitjean, 1883, toute la série des Coquelin Aîné ou des Coquelin Cadet), Portrait de la mère de l’artiste (1887), Madame Parisot lisant son journal (1888), Les Souvenirs (1891), Le repas frugal (1894), Le pain (1894), Portrait de M. Gustave Paul (1896), , etc.
2° des œuvres réalistes et quasi photographiques, qui semblent commencer avec Un peu de repos, d’après une phototypie (1883, œuvre qui réjouit les Impressionnistes de l’époque) et qui confirment leur magie, avec Les Buveurs ou Le Travail du lundi (1884), Portrait de Mme Coquelin mère (1885), Portrait de Mme Constantin (1885), Autoportrait au chevalet (1887), Toëra, Tunisienne lavant (1887), Jeune nancéienne dans un paysage de neige (1887), Le Déjeuner des canotiers ou Les canotiers de la Meurthe (1887), Portrait de Madame Paul (1888), l’Idylle sur la passerelle (1888), La Toussaint (1888), Camille Majorelle (1888), Portrait de Mysette Wiener (1889), El Kantara, La fileuse (1892), l’Autoportrait (1895), le Chagrin d’enfant (1898), La Douleur (1898), Soleil mourant (1904), l’Etude pour le portrait de Mlle Fischer (1913), L’Etudiante (1924), etc.
3° des œuvres réalistes tirant sur le fantastique, comme Hercule et le taureau de Crète, 1879, Le sacrifice d’Isaac (années 1879-80), Bacchus ivre (1881), Au pays des nuées (1898), et donc Ombres portées qui est une œuvre naturaliste / réaliste / pré-expressionniste, avec une touche de fantastique,
4° des dessins. Les dessins auront eu une grande importance dans l’œuvre de Friant, en particulier les dessins de visages, car c’est justement à cet endroit que Friant fait passer ses peintures du naturalisme au réalisme photographique. Photographie et dessin ont pour idéal l’exactitude, soit le maximum de précision, qui vient faire contraste sur le fond du pictural pur (le naturalisme).
L’enjeu de l’analogie
L’important, c’est donc l’analogie. Tout réalisme invente sa manière en termes d’analogie. L’image réaliste est une image qui se rapproche analogiquement d’une réalité, c’est une représentation indirecte du réel, mais qui entend le transcrire fidèlement, et on voit que son idéal aura été la photographie.
Comme dit Proust, «nous sentons dans un monde, nous pensons, nous nommons dans un autre, nous pouvons entre les deux établir une concordance mais non combler l’intervalle (3)» . Il faudra alors trouver des équivalents, des analogues, pour faire passer l’esprit du plan de la sensation à celui de l’image et du langage (et retour…).
On peut poser les choses ainsi: l’image peinte est à l’image mentale du peintre ce que cette image mentale est à l’image du réel de référence, qu’il soit empirique ou idéel. Elle serait ce qui donne le plus d’information sur le réel, à condition qu’il y ait lucidité et plasticité dans le degré de précision (il faut rompre avec le mythe de l’exactitude, qui a tant trompé les théoriciens au moment de l’apparition de la photographie).
La peinture n’est en effet pas le réel, elle est fonction du réel. Friant, lui, assume cette déformation et cette transformation dues au travail de l’esprit, avec ce défi: ne pas montrer ce travail de l’esprit. La présence du réel, son apparition ne sont pas restituées de la même manière, et pourtant ce sont deux formes du réalisme, avec deux techniques de restitution du réel très voisines, via la photographie et le modèle qu’elle constitue… C’est pour cette raison qu’il y a chez Friant deux stratégies de restitution du réel par et dans l’image picturale. Il y a la voie du pictural pur, autonome, et il y a celle du dessin dans la peinture même (mais aussi dans les dessins…), qui entend rivaliser avec la photo.
La première voie, celle du pictural pur, suggère le thème, la posture, la composition. La peinture peint, autonome — ce qu’elle a toujours fait. Elle fuit devant l’idéal photographique (c’est pour elle un moment de crise au milieu du XIXe siècle), elle se réfugie derrière la plus haute subjectivité du style, elle réinvente la peinture comme réalité sui generis, où le réel observé n’est qu’un prétexte, un stimulus pour l’exercice de style de l’œuvre.
Comment penser philosophiquement ce problème? La phénoménologie husserlienne distinguait, dans l’acte d’intentionnalité de la conscience, qui est comme une ellipse, avec deux foyers, le foyer du sujet (la noèse) et le foyer de l’objet, du réel, le noème. Eh bien, dans cette première voie, la manière naturaliste de Friant est essentiellement du côté de la subjectivité artistique, du style singulier, de l’expression, bref, la noèse. En revanche, toutes les œuvres qui louchent sur le dessin et sur l’idéal d’exactitude sont du côté du noème. L’image que l’esprit observe du fragment du réel sélectionné (photographié) commande, dirige, s’impose de manière souveraine. C’est de la peinture photographique parce que c’est de la peinture dessinée.
En ce sens, on voit que la distinction des deux manières chez Friant révèle la complexité du réalisme et le dialogue qui s’instaure dans l’idéal de la peinture entre dessin, photographie et peinture pure. Friant assume la complexité artistique du réalisme, dont le projet déclaré est certes un peu simpliste (la restitution du réel dans l’œuvre d’art), parce qu’il sait que dans l’activité de l’artiste réaliste il y a divers degrés de précision, de modification, de transformation, de déformation, de variation, d’abstraction, d’idéalisation, et ce jusqu’à l’idéal d’exactitude. Par moments, à certains endroits des œuvres concernées, on sent chez Friant l’idéal que réalisera encore plus parfaitement que lui Norman Rockwell.
La présence du réel
Il y a ainsi un effet subjectif des toiles hyperréalistes et photographiques de Friant, c’est la surprise de la présence. C’est ici qu’elle dispose d’une grande puissance de production d’admiration. Nous sommes en effet fascinés devant la réussite de cet effet de réel, de cette illusion artistique et fictive. Quand Dürer et Chardin veulent peindre une fourrure de lièvre ou le plumage d’un oiseau, ils savent qu’ils n’ont pas à peindre tous les poils, toutes les plumes, car ils doivent peindre une illusion de fourrure et une illusion de plumage… Reste à peindre parfaitement l’illusion…
Or, la réalité permanente de ces toiles, c’est la perfection dans l’achèvement. Autrement dit: la puissance d’affirmation des œuvres.
Le problème crucial de Friant est alors: jusqu’où aller dans la mimèsis, c’est-à-dire: quand s’arrêter(4)? Quand poser le pinceau? Quel serait le coup de pinceau de trop? Comment sait-on que ce mouvement vers l’exact, ce mouvement dont le milieu est le précis, comment sait-on que ce mouvement doit être arrêté? Le difficile, c’est de s’arrêter, de savoir quand s’arrêter. Réponse: l’artiste le sait par le savoir intérieur de la nécessité intérieure de l’œuvre, qui réduit au silence les questions sans fin de l’artiste. Savoir énigmatique, mais effectif. Nous en avons des preuves: la perfection des œuvres. Et qui nous réduit du même coup au silence. Il est donc temps de se taire, et de regarder les tableaux…
1 Et cette question de l’affect, cette question du lien entre l’affect et la forme inventée, Mô l’exposera avec Ombres portées.
2 Perspective qui, on le rappelle, conçoit deux pyramides ou deux cônes imaginaires, l’une entre mon esprit et le mur du tableau avec les lignes visuelles et l’œil du cyclope, l’autre dans le mur, dans le tableau lui-même, avec les lignes et le point de fuite…
3 Le côté de Guermantes, T. I, Livre de poche, p. 58.
4 Ce que dit Audiberti du poème, vaut pour toute œuvre d’art en général, il suffit de transposer le discours: «Le poème avait débuté par un premier avatar qu’il fallait faire semblant de croire suffisant mais qu’on savait insuffisant. (…) Il ne suffisait pas au regard de ce que notre grandeur requiert de notre constance. A partir de quel degré de solidification un texte poétique emplit-il à ras bord sa faculté de se condenser pour s’étendre ou de s’étendre encore sans se noyer? A quel moment est-il fini? A quel moment un poème est-il fini? Sans doute lorsqu’il tranche. Lorsqu’il tranche? Il ne s’agit pas, bien sûr, de se montrer obscène, impie, ni de se présenter sous un carapaçon tarabiscoté (quoique à certains moments du monde historique, il convienne, peut-être, pour le poète, d’instaurer, de codifier des usages linguistiques surprenants, d’écrire dans le dialecte franc du lendemain). Trancher sur le monde, rompre l’ordre du monde, introduire dans le monde, sous le manteau d’une modulation matérielle, le ferment d’une appartenance hétérogène, il y faut beaucoup de tact. Il faut que le poème soit assez lourd de globes de terre à ses racines pour que le comprenne la lettre, ou, tout au moins, quelques-uns de la terre, ces quelques-uns qui comptent pour tous. Et qu’il soit, cependant, givré de signes étrangers, couronné de pastels, de vitraux, de pétales en forme de pronostic. Mais, pour trancher, pour faire scandale, le poème doit être tendu dans son propos, grave dans son effort, délirant de sagesse, légèrement industriel dans sa carrure et, de toute façon, assez caporal.» (Audiberti, La nouvelle origine, Gall., coll. Poésie, p. 273-274)